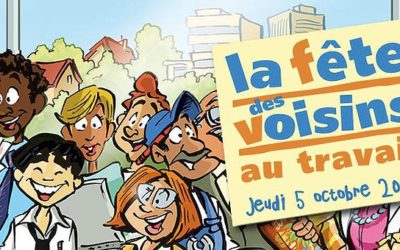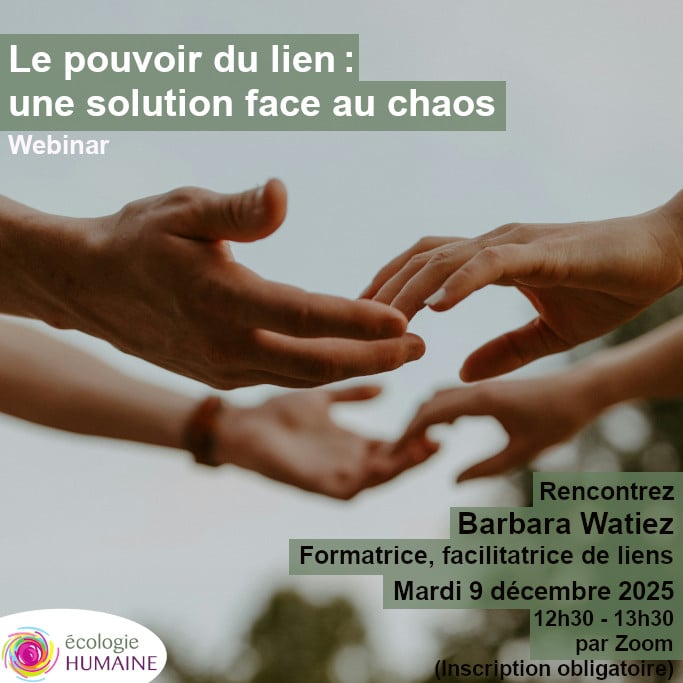Patrice Bonduelle est notaire à Paris, où il co-dirige un département dédié à la transmission patrimoniale. Il raconte, avec simplicité et humanité, les enjeux concrets de l’héritage : comment le droit s’articule avec les émotions familiales, la gratitude, les tensions, et la responsabilité intergénérationnelle. Une parole rare, nourrie d’expérience, de finesse et d’humilité.
Le métier de notaire, accompagnateur des familles
Patrice Bonduelle, notaire : “Un notaire accompagne des familles, parfois sur plusieurs générations, dans des situations variées : donations, successions, contrats de mariage, mais aussi divorces et séparations, ainsi que tout ce qui a trait à l’achat et la vente de biens immobiliers. Souvent, un lien humain fort se noue dans la durée.
L’héritage : introduction
On parle beaucoup d’héritage en France actuellement ; beaucoup dénoncent la part excessive de la transmission dans l’économie et les inégalités qu’elle peut renforcer. Mais l’héritage, en soi, n’est pas critiquable : il est une manière légitime d’acquérir un bien, même si la fiscalité française est lourde (jusqu’à 60 %).
Aujourd’hui, on hérite souvent entre 60 et 70 ans, quand on a fini sa propre carrière professionnelle et que l’on est déjà en train d’organiser la transmission à ses enfants. Un âge, finalement, où l’on n’en a plus vraiment besoin car ce n’est plus un tremplin pour démarrer dans la vie. Pour certains, c’est du superflu, ce qui transforme notre rapport à l’héritage.
Transmettre tôt, transmettre bien
Il est plus judicieux de transmettre progressivement dès 55 ou 60 ans, si la situation le permet, pour deux raisons :
- L’utilité est plus forte pour les jeunes générations : l’argent est plus utile à 30 ans qu’à 65.
- La fiscalité est avantageuse : la loi incite à donner en plusieurs fois, et au plus tôt, pour réduire les droits de successions.
« Mourir pauvre » : une philosophie de vie
Il faut mourir le plus pauvre possible ! Cela peut paraître paradoxal car cela nécessite de démonter, détricoter de son vivant, tant qu’on en est encore capable, tout ce que l’on a construit durant sa vie.
En effet, on peut considérer qu’avoir transmis dans de bonnes conditions l’essentiel de son patrimoine avant sa mort à ses proches fait partie de notre plan de vie. Sans imprudence, bien sûr – en gardant de quoi vivre décemment et sans dépendre de ses enfants autant que faire se peut – mais comme dans une logique de vie.
Savoir recevoir : gratitude et liberté
Recevoir un héritage, c’est recevoir un cadeau. Rien ne nous est dû. Nos parents auraient pu tout dépenser. Il faut donc recevoir avec gratitude et assumer la responsabilité morale que cela implique.
Autre point d’importance : faire attention à l’idolâtrie des biens matériels. Certaines familles s’imposent la conservation de biens familiaux – maisons, châteaux – au nom de la tradition. Mais attention à ce que ces biens ne deviennent pas un fardeau et ne créent des drames au sein des familles et des couples. Il faut rester libre de vendre, de passer à autre chose ; ça doit rester joyeux, pour toutes les générations.

Quand l’héritage divise
Un poison familial trop courant est de croire que l’on hérite en proportion de l’amour reçu. Ce malentendu génère souffrance et conflits. Il faut savoir dépasser cela, accueillir ce que l’on reçoit sans faire de comparaisons.
Par ailleurs, les parcours de vie éloignent parfois les fratries. L’héritage devient alors un révélateur de ces tensions, voire les accélère. Il faudrait plutôt se rappeler ce qui unit : l’histoire familiale commune – vacances en famille, difficultés et joies traversées, etc. Et distinguer ce qui semble le plus important pour nous. Cette famille ou le bien matériel ? Ceci, en faisant tout de même en sorte de rester un maximum dans l’équité.
Cela me fait penser à une histoire récente : un homme, conscient d’un déséquilibre dans les biens hérités, et persuadé que sa sœur avait manipulé ses parents pour être favorisée financièrement tout au long de sa vie, décide de la préférer à tout le reste, plutôt que de revendiquer ses droits sur l’héritage. “Je n’ai qu’une sœur, mes enfants n’ont qu’une tante. C’est le plus important”. Un choix de paix familiale, lucide et généreux.
Hériter : quelques pièges à éviter
En principe, les conjoints (belles-sœurs, beaux-frères) n’ont pas leur place dans les discussions successorales. Ils ne devraient y participer que si tout le monde le souhaite, et s’ils ont un rôle reconnu de médiation ou d’aide. C’est vraiment au cas par cas que l’on peut faire ce choix.
Le pire, au moment de l’héritage, c’est le non-dit. J’insiste pour que les parents, s’ils prennent des options spécifiques en faveur de tel ou tel – en se faisant conseiller pour rester justes et en étant raisonnables et attentifs à ne pas blesser, doivent avoir le courage de la vérité, en en parlant avec leurs enfants, même au prix de débats un peu musclés. Une inégalité découverte après coup est une double blessure : celle du contenu non équitable, et celle du mensonge ou du silence autour de ce qui peut apparaître comme une spoliation.
L’équité dans les familles : aider sans diviser
Il arrive souvent que des parents doivent venir en aide à l’un de leurs enfants adultes, parfois sur une longue durée : en l’hébergeant gratuitement, en finançant les études des petits-enfants… Ce sont des soutiens significatifs. Le rôle des parents devient alors celui d’un appui durable, et cette situation pose inévitablement la question de la succession : faut-il envisager des compensations ? L’enfant qui a été le plus aidé doit-il être considéré comme ayant déjà reçu une part d’héritage, et donc recevoir moins lors de la succession ? Ce sont des questions à ne pas éluder.
La vie est imprévisible et certaines situations ne sont pas de la responsabilité de ceux qui les subissent. Il est donc fondamental que les parents prennent position et en parle avec le reste de la fratrie avec clarté et transparence. Il restera aux frères et sœurs à accueillir cette réalité et réagir avec autant de maturité et de douceur que possible ; en tant que notaires, nous intervenons pour donner aux familles les bonnes informations, afin qu’elles puissent prendre des décisions en connaissance de cause, et envisager des solutions équilibrées, dans un esprit de cohésion familiale.
Je trouve que ces situations sont très formatrices, surtout pour la troisième génération. Savoir que ses parents ont renoncé à une part de leur héritage au profit d’une tante, abandonnée par son mari à 35 ans (par exemple), peut être une véritable leçon de vie. Cela montre qu’il existe une manière digne et humaine de gérer les successions.
Héritage : à propos du don à une œuvre
Il est tout à fait possible – même en ayant des enfants – de léguer une part de son héritage à une association, une œuvre de charité ou une fondation.
Cela peut aussi être décidé par les héritiers eux-mêmes, grâce au don sur succession, un dispositif peu connu mais légal, permettant de rediriger une part de l’héritage vers une cause de son choix (celui des parents ou celui des enfants) sans impôt.
Hériter de la joie d’avoir une famille unie
Transmettre, c’est plus qu’un acte juridique. C’est un geste de vie, d’amour, et de conscience. Et recevoir, c’est apprendre à dire merci, à se sentir responsable, sans être esclave.
L’héritage ne doit pas diviser, mais relier. Il ne doit pas enfermer, mais libérer. Et peut-être que, dans cette dynamique-là, mourir pauvre devient une des formes les plus abouties de la générosité humaine.
J’insiste sur la transparence et le courage nécessaires de la part des parents, ainsi que sur la délicatesse et le sens de la justice des enfants. Il faut rechercher la justice, oui, mais sans excès ; il faut savoir faire preuve d’intelligence, de maturité et toujours garder en tête ce qui semble le plus important dans sa vie.”
Pour poursuivre sur cette réflexion, découvrez l’intervention de Gilles Hériard Dubreuil : créer et transmettre