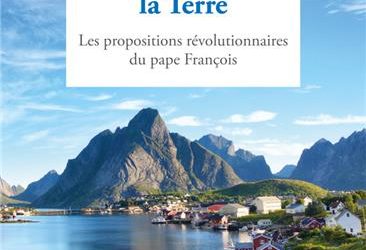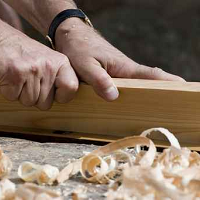 Au cours de ces deux derniers siècles, les découvertes technologiques et leurs applications dans l’habitat auraient-elles engendré autant de problèmes que de solutions ?
Au cours de ces deux derniers siècles, les découvertes technologiques et leurs applications dans l’habitat auraient-elles engendré autant de problèmes que de solutions ?
LE FAUX-MIRACLE DU MODERNISME, UNE UNIFORMISATION AU DÉTRIMENT DE LA SINGULARITÉ ?
A l’époque préindustrielle, les techniques de construction différaient d’aujourd’hui. On privilégiait alors l’efficacité et le pragmatisme, en s’appuyant sur les habitudes de vie et en tenant compte des spécificités des régions, en particulier le climat. Les bâtisseurs utilisaient les ressources locales, et le gabarit des matériaux de construction était fonction de ce qu’un homme pouvait porter.
« Les contraintes étaient une formidable source d’ingéniosité, les bâtisseurs devant toujours trouver des solutions innovantes »
Or, avec l’industrialisation massive de l’Europe au 19e siècle, les évolutions techniques ont rendu désuets les anciens modes de construction, ayant pour unité de mesure l’homme, et ont permis l’avènement du modernisme. Il a fallu trouver une nouvelle manière de faire de l’architecture. On ne raisonne désormais plus en termes de règles de construction, mais d’espaces et de fonctionnalités seulement. C’est dans ce contexte que les matériaux industriels ont pu trouver tout leur champ d’application.
Cependant, lorsque j’écoute des personnes parler du modernisme, j’entends beaucoup de critiques à son encontre. On reproche très souvent aux bâtiments de manquer d’âme. Faudrait-il pour autant revenir à un « art décoratif », à l’ajout d’ornements visant à donner un aspect plus artisanal aux objets industriels ? Le pastiche ne semble pas être une solution convenable.
Pourquoi alors ne pas traiter le sujet en profondeur, en revenant aux bases fondamentales de la construction ?
VERS UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET TRADITIONNELLE ?
On ne s’étonne plus de voir du granit chinois utilisé en Bretagne pour faire de la construction régionale. Lorsque nous achetons un produit, nous avons le choix entre une multitude de formes, de coloris et de finitions, tous plus originaux les uns que les autres, mais basés sur une technique industrielle uniforme. Nos meubles viennent souvent des mêmes fabricants et, par conséquent, se ressemblent tous.
« Notre époque actuelle a tristement réussi à faire la synthèse entre le plus mauvais de l’art décoratif et du modernisme réunis »
Toutefois, il existe aujourd’hui un problème bien plus urgent que la simple question de l’aspect de notre cadre de vie : ces techniques industrielles modernes ont un impact écologique important et, bien que permettant de réaliser des concepts architecturaux séduisants, ne sont-elles pas devenues un luxe que nous aurons du mal à nous offrir dans l’avenir ?
Car si ces techniques ont indéniablement permis de réduire les coûts de construction, participant ainsi à l’augmentation du pouvoir d’achat général, elles précarisent l’emploi, puisqu’elles requièrent généralement peu de qualifications. Il est donc urgent de repenser sainement le secteur de la construction, en se basant sur l’unité de mesure essentielle de l’architecture, l’échelle humaine.
Ce rééquilibrage pourrait consister à remettre au goût du jour matériaux locaux et savoir-faire éprouvés, sans pour autant abandonner un certain pragmatisme quant aux techniques modernes les plus pertinentes. Cela permettrait de redévelopper une filière hautement qualifiée, génératrice d’emplois à haute valeur ajoutée, capable de proposer des réalisations de qualité et réellement originales, avec des matériaux plus authentiques.
Il s’agit donc de remettre l’homme au cœur du processus, en promouvant l’artisanat, c’est-à-dire des procédés nécessitant l’apprentissage d’un savoir-faire technique, afin de redonner de la dignité à l’homme par la reconnaissance de son travail. Concevoir des produits simples et adaptés, c’est également garantir la maintenance, et donc la durabilité de l’édifice.
En parallèle, des réseaux d’approvisionnement locaux doivent être mis en place, chaque région ayant sa spécificité, son climat et ses matériaux de prédilection. Développer un tissu économique de proximité, c’est aussi créer du lien social, tout en encourageant et fidélisant ses partenaires.
Sans tomber dans le piège du régionalisme, qui consisterait à décréter que tel type d’architecture serait le style traditionnel authentique, il est possible de trouver des solutions locales, mettant en valeur la créativité infinie de l’homme à travers un savoir-faire à réinventer, dans le plus grand respect des ressources naturelles à notre disposition.