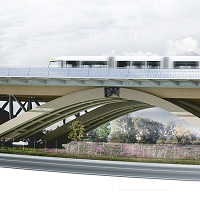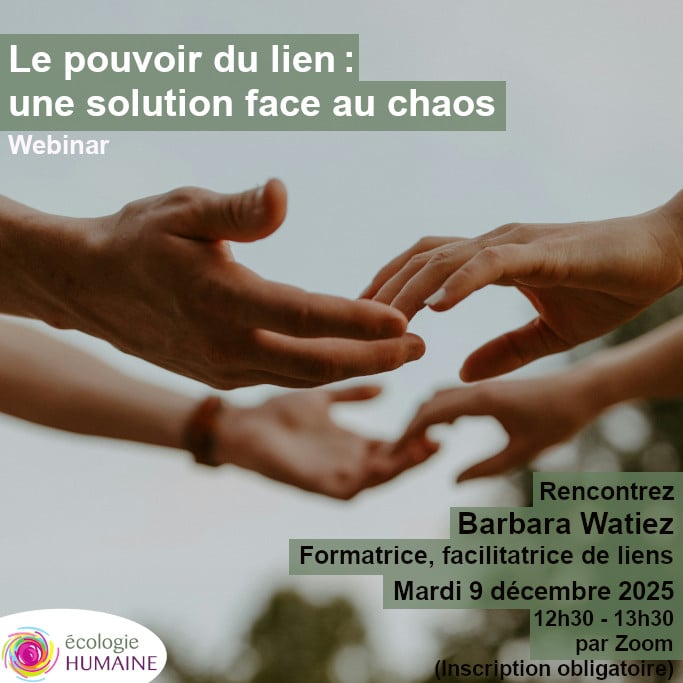À Paray-le-Monial, Baptiste Fondeur autoconstruit une maison en paille porteuse. Un projet exigeant, où se mêlent écologie, autonomie, transmission et sobriété heureuse.
Le choix de l’autoconstruction : s’engager, économiser, apprendre et transmettre
Baptiste Fondeur, ingénieur : “Construire sa maison soi-même, c’est d’abord un projet familial. Il y avait une envie forte de faire différemment, de sortir des chemins tout tracés pour s’engager pour l’écologique en faisant le choix de la sobriété. En faisant par nous-mêmes, nous réduisons les coûts et nous nous réapproprions des savoir-faire oubliés.
Au début, je ne savais ni taper avec un marteau, ni utiliser une visseuse. Alors, avec Klára, on est parti trois mois sur les routes, apprendre sur des chantiers participatifs grâce à la plateforme Twiza, un réseau d’entraide autour de l’habit écologique, qui met en lien autoconstructeurs, bénévoles avides d’apprendre et professionnels. On a mis la main à la pâte, on a appris, rencontré, échangé. C’était bien plus qu’un simple apprentissage technique : une école de vie.

Autoconstruction en paille : confortable thermiquement, écologique, peu coûteux
Rapidement, la paille s’est imposée comme une évidence. Ce déchet agricole, très bon isolant, est économique, disponible localement et possède un excellent déphasage thermique très appréciable lors des canicules estivales. Nous avons choisi la technique de la cellule sous tension (CST) : l’une des deux méthodes de construction en paille porteuse avec la méthode Nebraska : la paille y est à la fois porteuse, isolante et contreventante.
Contrairement à d’autres méthodes où le bois est l’élément qui assure la solidité des murs (ossature bois, poteau-poutre, GREB), ici, c’est la paille qui fait tout. Le bois est réduit à sa plus simple expression, ce qui nous permet d’épargner la forêt… et notre budget.

Des idées reçues à dépasser : durabilité, feu, humidité
Beaucoup s’inquiètent de la solidité d’une maison en paille. Pourtant, la plus ancienne maison en paille encore debout, qui est située aux États-Unis, date d’avant l’invention du ciment ! En France, la maison Feuillette, près de Paris, a fêté son centenaire. La paille compressée, enduite de chaque côté (terre ou chaux), est coupe-feu 2h et très durable… à condition d’éviter l’humidité.
On résume souvent en disant qu’il faut “de bonnes bottes et un bon chapeau”. Autrement dit, de bonnes fondations et une toiture bien entretenue. Si la paille est bien protégée, elle peut sans problème traverser les siècles !

Vivre un projet global : autonomie, sobriété, résilience
Notre maison fait 130 m², dont 100 m² chauffés. Elle est implantée sur un terrain d’un hectare que nous transformons en jardin-forêt comestible, avec un potager, des arbres fruitiers et des moutons.
On récupère l’eau de pluie, on produit notre électricité grâce à des panneaux solaires, et on utilise des toilettes sèches.
À mes yeux, l’intérêt des toilettes sèches n’est pas tant d’économiser de l’eau que de récupérer les nutriments pour maintenir la fertilité des sols sans recours aux engrais chimiques. On les composte, puis on les utilise au pied des arbres. Prochainement, on va passer à des toilettes à séparation, pour encore mieux valoriser l’urine qui est riche en azote, et qui peut être directement utilisée au potager sans danger.

Le poêle de masse : efficacité énergétique, moindre pollution et confort thermique
Nous chauffons notre maison avec un poêle de masse. On ne consomme que 1,3 stère de bois par an, soit environ 80 € de chauffage annuel. Le principe : un feu intense, qui chauffe une grande masse, laquelle restitue la chaleur doucement pendant 12 heures. Pas besoin d’entretenir le feu constamment, et surtout, une combustion beaucoup plus propre et efficace, sans polluer l’atmosphère.
Si ce mode de chauffage est très efficace, notre faible consommation vient avant tout du fait que la maison est conçue selon les principes bioclimatiques : bonne orientation, isolation, inertie thermique, matériaux naturels perspirants qui laissent passer la vapeur d’eau. Résultat : un confort thermique optimal, même en hiver, sans humidité.
Les imprévus du chantier en autoconstruction : entre stress et résilience
Un projet comme celui-là, c’est beaucoup de temps, d’énergie et… d’imprévus. Avec nos enfants en bas âge, un emploi à plein temps et un chantier à gérer, on peut être sous tension.
Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Il nous est même arrivé de voir l’un de nos murs et notre barnum emportés par une mini tornade !
Mais on tient bon. Chaque coup dur nous a appris quelque chose. On comprends peu à peu que tout prend plus de temps que l’on ne l’imagine, surtout en autoconstruction, et on réapprend la vraie valeur des choses.

Transmettre : une maison, mais surtout un mouvement
Aujourd’hui, notre maison n’est pas encore terminée, mais déjà, elle intéresse. Chaque été, nous accueillons des dizaines de bénévoles qui viennent découvrir et apprendre l’autoconstruction. Certains sont curieux, d’autres prévoient de construire leur maison. Il y a aussi des personnes qui songent à une reconversion professionnelle et des architectes ou ingénieurs du bâtiments qui sortent d’école et qui veulent goûter au terrain et tester autre chose que le béton… Ils peuvent être très bons en bricolage ou parfaitement novices, comme nous à nos débuts.
La journée, on construit ensemble. Le soir, je donne des conférences : retour d’expérience, bases du bioclimatisme… Ce sont des moments très riches. Moi qui n’ai plus le loisir de voyager autant, c’est à travers toutes ces rencontres, que je suis dépaysé.
Agir pour demain : individuel ou collectif ?
On me demande souvent : « Est-ce que ça sert vraiment, d’agir à l’échelle individuelle ? » Je crois que oui, à condition d’inspirer d’autres. Réduire son impact ne suffit pas, il faut transmettre ! Le livre No Impact Man m’a marqué plus jeune. Il expliquait que l’effort individuel, seul, atteint vite ses limites et que c’est seulement en faisant boule de neige, qu’on peut avoir un véritable impact.
Je crois que c’est là que tout se joue : dans la dynamique collective, dans l’élan que l’on donne. Nos dirigeants doivent agir, c’est évident. Mais nous aussi. Chaque projet individuel, quand il s’ouvre aux autres, devient une force de transformation.
Quoi qu’il en soit, autoconstruire sa maison en paille, ce n’est pas juste un chantier. C’est un projet de vie, une expérience humaine, un engagement écologique, une aventure collective. C’est parfois dur, mais c’est aussi très joyeux, et on sait pourquoi on le fait !”

Vous voulez rejoindre ce chantier participatif ? Voici la page Twiza où contacter Baptiste Fondeur
Pour aller plus loin sur le sujet, découvrez le travail d’Hassan Fathy : un architecte révolutionnaire