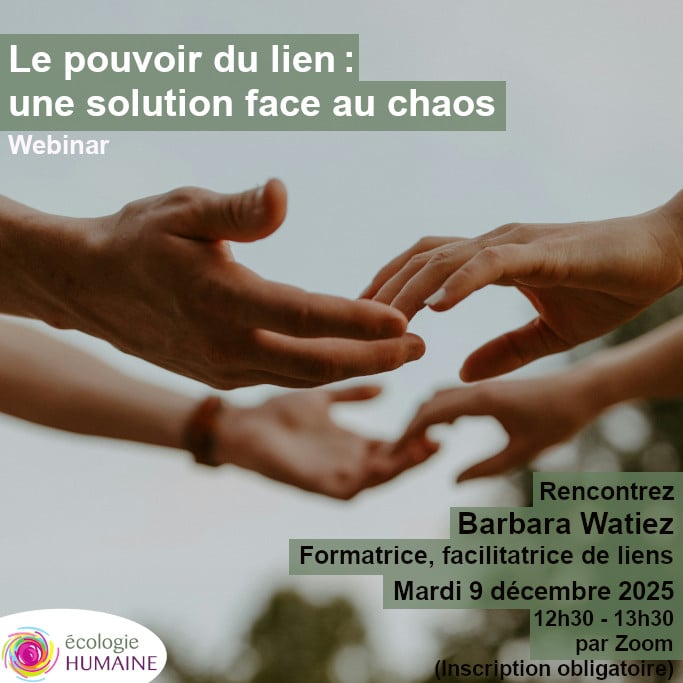À Compiègne, la municipalité a fait le pari de la démocratie participative en créant des comités d’intérêts locaux de quartiers. Une démarche ambitieuse et collective qui repose sur l’écoute, le dialogue et la co-construction de solutions adaptées au territoire. Xavier Bombard, conseiller municipal et délégué aux Comités d’Intérêts Locaux de Quartiers depuis 2020, raconte l’élaboration de cette initiative citoyenne.
Cette intervention a eu lieu dans le cadre du forum 2025 du Courant pour une écologie humaine, sur le thème “Comment débattre sans se combattre ?“.
Comités d’Intérêts Locaux de Quartiers : une réponse à la défiance démocratique
Face à la profonde crise de confiance entre les citoyens et leurs représentants politiques, la ville de Compiègne a choisi d’expérimenter une voie nouvelle : la démocratie participative à l’échelle locale, via la création de comités d’intérêts locaux de quartiers (CILQ), lieux de d’échanges, d’expression, de propositions et d’action collective pour les habitants.
Cette initiative repose sur une conviction forte : la vitalité démocratique peut renaître par l’engagement citoyen et la délibération collective. Dans un contexte où certains parlent de “démocrature” ou “d’hypnocratie” et dénoncent l’appauvrissement du débat public, redonner la parole aux habitants devient un enjeu essentiel.
Comités d’Intérêts Locaux de Quartiers : des objectifs clairs et structurants
La mise en place de ces CILQ répondait à plusieurs objectifs :
- Renouer la confiance entre élus et citoyens,
- Donner une voix aux habitants dans les décisions qui les concernent,
- Favoriser l’appartenance à la ville et l’engagement citoyen,
- Encourager la construction collective du bien commun.
Compiègne, avec ses quelques 40 000 habitants répartis en une quinzaine de quartiers, a ainsi opté pour la création de six comités, couvrant toute la ville, pour garantir un fonctionnement efficace et une animation réaliste.
Une organisation pensée pour l’équilibre et l’efficacité
La composition des comités a été conçue de manière à assurer la représentativité des habitants et l’indépendance de leurs réflexions :
- 1/3 des membres sont désignés par le maire,
- 1/3 est issu des associations locales,
- 1/3 est tiré au sort sur les listes électorales.
Chaque comité regroupe environ vingt membres, engagés bénévolement pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. L’animation de chaque comité est confiée à des volontaires, entre 2 et 4, qui bénéficient d’une formation à l’animation. Ces équipes d’animation sont soutenues par les élus référents du quartier, qui interviennent en tant que ressources mais ne dirigent pas les débats.
Les réunions, mensuelles, font l’objet de comptes rendus accessibles à tous.
Des principes éthiques et un fonctionnement transparent
Les comités s’appuient sur des valeurs claires : respect mutuel, transparence, amélioration continue des process. Quant aux débats politiciens, ils n’ont pas leur place dans ces CILQ.
Un forum annuel, organisé sur le parvis de l’hôtel de ville, permet de présenter les travaux accomplis et d’échanger directement avec les citoyens.
Comités d’Intérêts Locaux de Quartiers : de la consultation à la co-construction
Les comités interviennent sur des sujets variés : aménagements urbains, environnement, culture, santé, citoyenneté… Ils peuvent s’auto-saisir d’un sujet ou répondre à une demande de la municipalité. Le processus peut aller jusqu’à la co-construction de projets, avec un suivi en lien avec les services de la ville.
En cinq ans, plus de 80 dossiers ont été produits. Certains d’entre eux témoignent d’une véritable expertise citoyenne, saluée parfois même par les services techniques municipaux.
Des réalisations concrètes et exemplaires
Parmi les projets notables qui ont été proposés, on peut citer :
- L’aménagement des berges de l’Oise, mené avec la méthode “PAT miroir” de Gilles Le Cardinal.
- La politique jeunesse, qui a débouché sur la création d’un Conseil des jeunes, aujourd’hui expérimenté avec des élèves de 5e.
- La réflexion sur l’installation des bancs publics, avec un inventaire complet de la ville et des propositions concrètes.
- La lutte contre la désertification médicale, qui a contribué à enrichir les dispositifs aujourd’hui soutenus par l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC).
- Un projet de “journée citoyenne”, en cours de réflexion, où chacun pourrait donner un peu de temps pour participer au vivre ensemble dans la ville.
Une dynamique vertueuse entre élus, citoyens et services
Au fil des années, ces comités ont transformé les relations entre les acteurs de la ville. Les services, parfois sceptiques au départ, ont vu l’apport réel des propositions citoyennes. Les élus, eux, ont appris à faire confiance aux habitants et à intégrer leur expertise dans les processus de décision.
Les citoyens eux-mêmes ont découvert d’autres quartiers, rencontré de nouveaux visages, découvert le fonctionnement d’une municipalité et nourri un sentiment d’appartenance plus fort à leur ville.
Pour conclure : une culture du débat à réinventer
Cette expérience démontre qu’il est possible de débattre sans se combattre, à condition de partager une définition claire du bien commun. La “coopération conflictuelle”, fondée sur la confrontation constructive des idées, doit être encouragée. Elle ne signifie pas l’affrontement, mais la richesse du dialogue entre des points de vue différents.
La démocratie participative ne remplace pas la démocratie représentative, mais elle l’enrichit. À Compiègne, elle a permis d’impliquer activement des centaines de citoyens et de produire des projets concrets, utiles, portés par ceux qui vivent la ville au quotidien.
Découvrir une autre intervention du forum 2025 : Débattre sans violence : quelques bonnes pratiques à adopter – Laurana Glaudeix